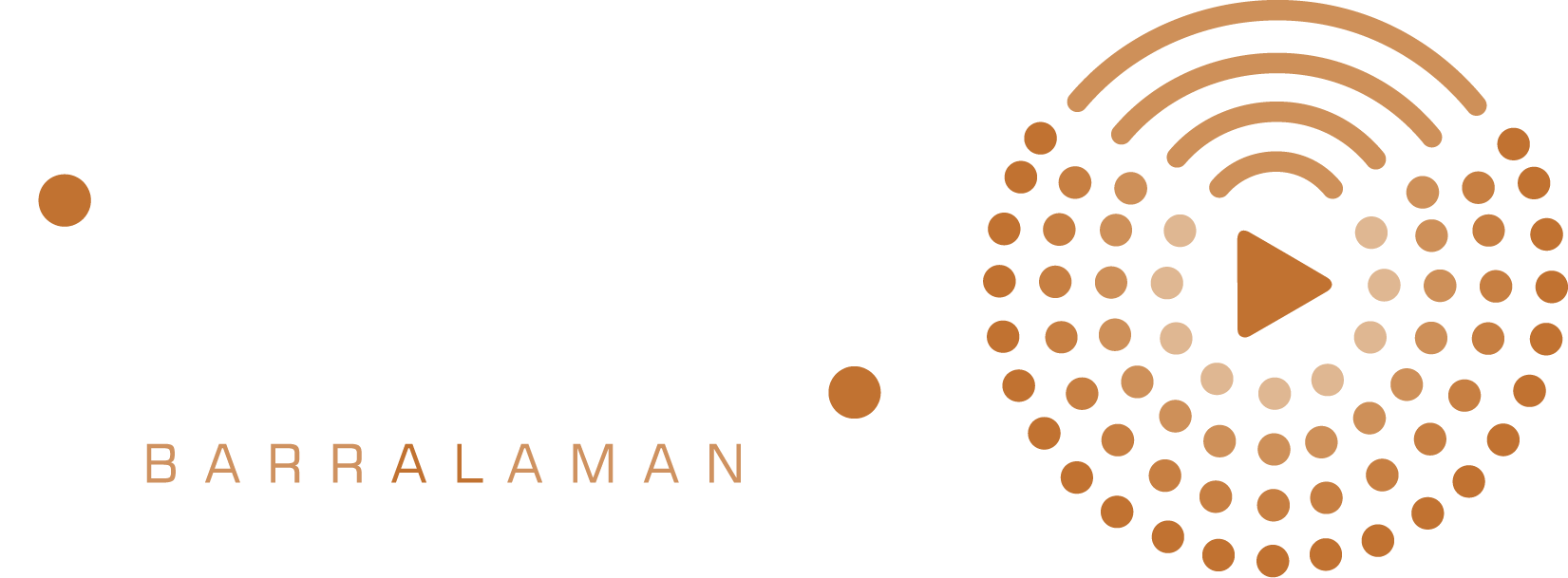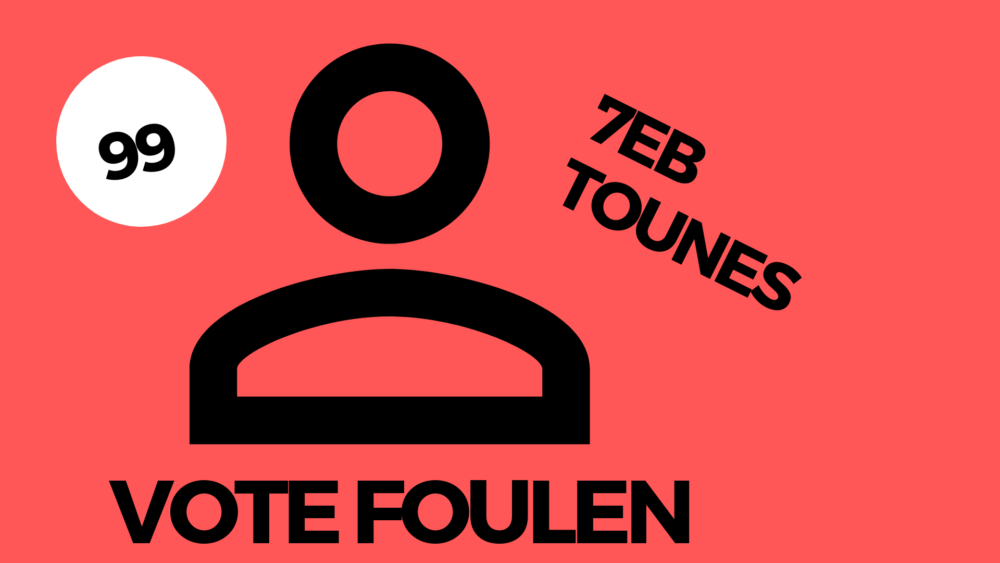Contents
Abdelkrim Zbidi est candidat pour les élections présidentielles anticipées de septembre 2019. Mohamed Slim Ben Youssef, doctorant en Sciences Politiques à l’Université IEP d’Aix en Provence nous propose sa lecture de son parcours.
Peu après la mort de Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier, les appels à M. Zbidi pour se porter candidat à l’élection présidentielle anticipée se sont multipliés. Le ministre de la Défense, proche du défunt président, est ainsi considéré comme son digne héritier par le parti Nida Tounes. Un constat partagé par plusieurs personnalités du spectre politique de “la famille centriste”. Dans un contexte d’intensification de la lutte entre les différents groupes d’intérêt pour contrôler les institutions de l’Etat, la candidature Zbidi a été soutenue et saluée par des segments larges de la scène politique. Mais qui est Abdelkarim Zbidi ? Pour un candidat qui n’a ni présenté un programme, ni exprimé une vision politique, que peut nous dire sa trajectoire politique de ce qu’il pourrait faire ou être s’il accède à la magistrature suprême ?
Zbidi: Le candidat malgré lui
Rappelons que, dans un premier temps, M. Zbidi n’avait pas exprimé d’ambition pour être le prochain locataire de Carthage. Sa candidature est le fruit d’une construction d’une bonne partie des forces politiques “centristes” qui se réclament de l’héritage de Bourguiba. Par la suite, une nouvelle ceinture, formée par une frange de démocrates, a renforcé l’édifice. Plusieurs universitaires, anciens ministres, hauts cadres et intellectuel.les soutiennent sa candidature. Leur argument ? M. Zbidi est au-dessus de la mêlée et sera un vrai rempart face à l’appétit politique rampant des “lobbies” qui menace les institutions de l’État. Selon cet argument, ce n’est plus seulement la démocratie naissante qui est en jeu : c’est la continuité même de l’État tunisien et de ses institutions. Mais pourquoi lui ?
Sa candidature est le fruit d’une construction d’une bonne partie des forces politiques “centristes” qui se réclament de l’héritage de Bourguiba.
Ses partisans présupposent chez lui une capacité à transcender les luttes entre clans qui déchirent l’État. Ainsi, il apparaît comme un homme providentiel aux yeux de ses soutiens. Mais quels sont les attributs personnels de M. Zbidi qui confortent une telle appréciation ?
Un médecin devenu ministre de la Défense
Zbidi est titulaire d’un doctorat en médecine de l’université Claude Bernard de Lyon. Coordinateur de la formation des techniciens supérieurs à la faculté de médecine de Sousse entre 1981 et 1988, il est également, durant la même période, chef du département des sciences fondamentales.
Le candidat à la présidentielle anticipée commence à occuper des fonctions ministérielles sous Ben Ali. Il est secrétaire d’État auprès du premier ministre, chargé de la recherche scientifique et de la technologie pendant une année en 1999. Il occupe successivement le poste de ministre de la santé publique en 2001, puis celui de ministre de la recherche scientifique et de la technologie en 2002. Il occupe le poste de ministre de la Défense nationale à deux reprises après la révolution : de 2011 à 2013, dans les gouvernements Essebsi et Jebali, puis fait son retour en septembre 2017 au deuxième gouvernement de Chahed. Tout comme Mohamed Abbou et Elyes Fakhfekh, Zbidi a fait partie de la Troïka, mais cette expérience de ministre régalien n’a pas été retenue contre lui. Discret, M. Zbidi s’est gardé de prendre part aux débats politiques durant cette période. D’un autre côté, sa trajectoire d’homme de la haute administration conforte pour son électorat la figure d’un homme d’État transcendant les luttes politiciennes.
Un candidat “au-dessus de la mêlée” ?
Son long parcours dans la haute administration lui vaut une réputation “d’homme de devoir”, celui qui ne déserte pas. L’absence d’affiliation politique officielle renforce cette image de commis de l’État. Pourtant, sa proximité personnelle de Béji Caïd Essebsi, sans appuyer la thèse d’une affiliation politique “cachée”, est le fondement d’une “proximité politique” qui ne dit pas son nom. D’abord parce que l’un des arguments de sa candidature, dans un premier temps, a été fondé sur son incarnation de l’héritage d’Essebsi. Mais aussi parce que ses propositions politiques s’en réclament.
Abdelkrim Zbidi n’est pas favorable au régime parlementaire actuel. Pour lui, dans ce régime, personne ne peut être tenu pour responsable des choix politiques effectués. Il reprend l’argument, partagé avec d’autres candidats, selon lequel la dyarchie de l’exécutif introduit une confusion sur les rôles dans la mise en place des politiques publiques. Bien qu’il défende l’option d’un référendum pour choisir le type de régime politique à instaurer, tout porte à croire qu’il est en faveur de l’option la plus centralisatrice du pouvoir exécutif : le régime présidentiel. Une option longtemps défendue par Béji Caïd Essebsi. Autre indice : M. Zbidi prône une “réconciliation globale”, plus particulièrement avec Ben Ali et ses collaborateurs. Or on sait combien le Président défunt a défendu son projet de loi sur la réconciliation économique, et surtout à quel point ce fut un catalyseur de luttes politiques.
Une tentation autoritaire ?
Les récentes déclarations de M. Zbidi sur les événements du 27 juin dernier révèlent un rapport à l’armée et à sa place dans la politique institutionnelle qui a posé problème à plusieurs observateurs. Sa prédisposition à utiliser les moyens de l’armée pour bloquer les activités du parlement dévoile une tentation autoritaire difficile à masquer. Alors même que les pro Zbidi saluent une attitude “d’homme d’État” face à une “tentative de putsch” (sic!). Le danger que fait peser cette réaction sur le fonctionnement démocratique des institutions politiques a été largement commenté. Mais ce n’est pas tout : c’est l’utilisation de cet “incident” comme argument de campagne qui est encore plus problématique. Que peut nous dire l’évocation de cet “incident” par M. Zbidi qui invoque la “raison d’État” ? Aux yeux du candidat ou de sa campagne, cet argument pourrait résonner avec une demande d’autorité. Dans un contexte où la puissance étatique est tiraillée par des luttes entre différents groupes d’intérêt, plusieurs candidat.es vendent un “État fort” dans leurs programmes. Mais cette demande laisse entrevoir le spectre d’une dérive autoritaire.
Sa prédisposition à utiliser les moyens de l’armée pour bloquer les activités du parlement dévoile une tentation autoritaire difficile à masquer.
En effet, envisager d’instrumentaliser des moyens militaires pour empêcher une réunion de député.es, au moment même où peu d’informations filtraient sur l’état de santé du Président, peut difficilement s’apparenter à une action pour “empêcher un coup d’État”. Ce serait plutôt cette intervention par la force armée dans le fonctionnement des institutions élues qui serait qualifiable de “coup d’État” si elle avait eu lieu.