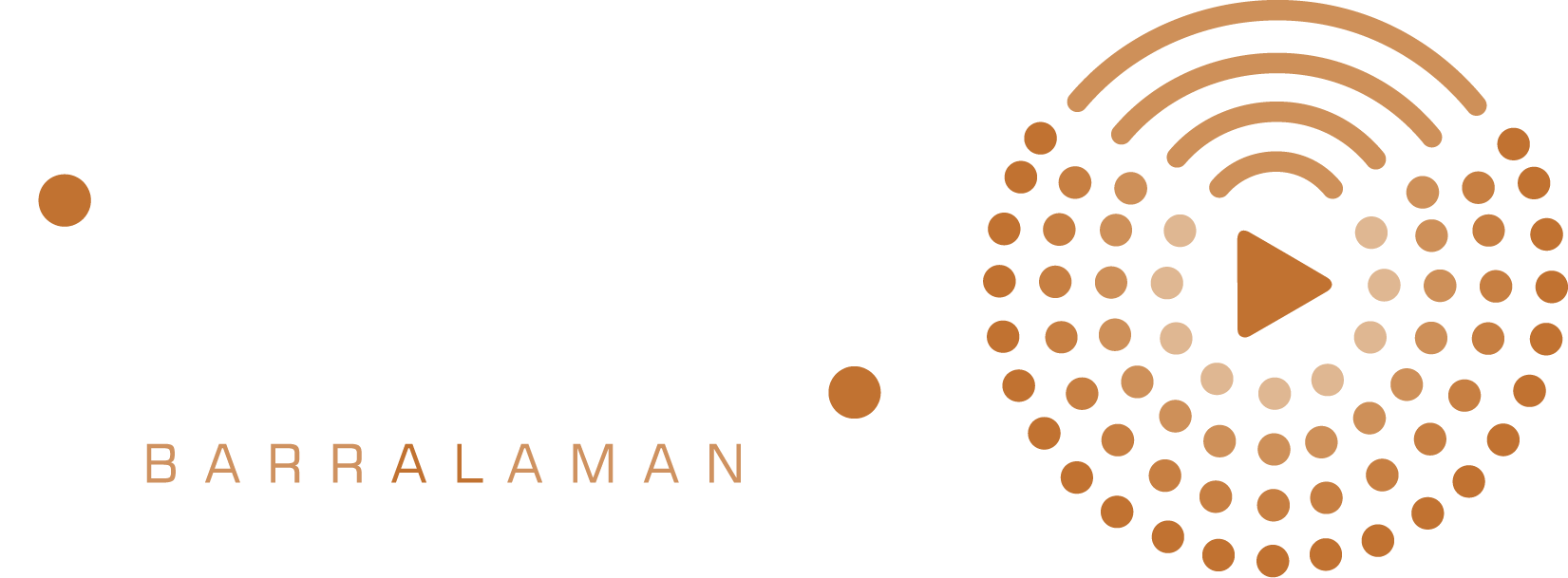En cours de chargement…
En cours de chargement…
Sept ans après la chute de la dictature en 2011, corruption et crise de confiance envers les élites politiques et les représentants de l’Etat font partie des maux endémiques qui rongent la Tunisie. Ces phénomènes ne sont pas une fatalité. Des mécanismes existent pour les endiguer et réinsuffler la confiance des citoyens à l’endroit de leurs représentants. La déclaration de patrimoine pourtant pourrait être un de ces mécanismes. Elle constituerait un outil efficace pour lutter contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts, si elle est correctement mise en place.
En Tunisie, la loi sur la déclaration de patrimoine a fêté ses trente ans en 2017. Cet anniversaire coïncide avec la révision de ce cadre légal au Parlement notamment avec un projet de loi gouvernemental et des propositions de lois émanant des élus. Ces textes ont pour but de mettre à jour les procédures et de les adapter aux exigences constitutionnelles mentionnées dans l’article 11 de la Constitution de 2014 qui stipule que «Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée des représentants du peuple, de membre des instances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure doit déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi ». Mais avant de promulguer une nouvelle loi, il est nécessaire d’évaluer celle qui la précède, de déceler les erreurs commises et de comprendre les failles non seulement du texte, mais aussi de sa mise en œuvre, afin de ne pas les reproduire.
En tant que média, Barr al Aman s’est intéressé à l’usage de cet outil pour garantir l’intégrité de la vie politique et lutter contre la corruption. Ainsi, pour évaluer cette politique publique, nous avons procédé en cinq étapes :
- Tout d’abord, nous avons étudié la législation en vigueur.
- Ensuite, nous avons analysé la base de données de la Cour des comptes, le dépositaire des déclarations de patrimoine. Cette base consiste en une liste de toutes les déclarations déposées pendant trois décennies.
- Puis, nous avons questionné la volonté du législateur à travers une analyse des débats parlementaires de mars 1987. De plus, un entretien avec le premier ministre de l’époque Rachid Sfar, à l’origine de la loi 17/1987 portant déclaration sur l’honneur des membres du gouvernement, nous a permis saisir les motivations de l’Exécutif.
- Pour comprendre concrètement la pratique de la déclaration de patrimoine, nous avons aussi interrogé des personnes soumises à cette procédure, ainsi que des responsables à la Cour des comptes.
- Enfin, nous nous sommes penché sur les expériences comparées : qu’est-ce qui pousse un Etat à adopter ou réformer la déclaration de patrimoine ? Quelle est la latitude qu’offre la législation aux citoyens, acteurs politiques ou journalistes pour garantir une intégrité de la vie publique et ne pas biaiser le jeu démocratique et institutionnel ?
Le bilan ne pousse pas à l’optimisme. Il n’est pas exagéré de dire que la loi sur la déclaration du patrimoine de 1987 n’a servi à rien.
La Tunisie ne s’est dotée d’aucun outil de contrôle et de sanction, contrairement à d’autres pays, car les déclarations sont sous le sceau du secret. D’ailleurs, ni les journalistes, ni la société civile n’ont pu utiliser les déclarations de patrimoine pour veiller à l’intégrité de la vie politique. Un secret maintenu dans le projet de loi examiné en plénière en juin 2018 au parlement tunisien et même renforcé par la criminalisation de la publication du contenu des déclarations.
Les chiffres sont éloquents. En trente ans, plus de 25.000 déclarations ont été déposées. Combien de personnes auraient dû déclarer au total ? Nul n’est en mesure de répondre. En effet, à notre connaissance, aucun service de l’Etat n’a fait le suivi des nominations et fin de fonction afin d’identifier les contrevenants. Ainsi, ce sont autant de personnes hors-la-loi et hors d’atteinte. Au-delà de ceux qui n’ont pas déclaré, si on se focalise sur les déclarations déposées, aucune n’a été utilisée par la justice ou tout autre service étatique, de l’aveu de la Cour des comptes. Durant cette même période, un tiers des déclarations a été déposé en 9 mois, entre avril et décembre 1987. Deux tiers l’ont été pendant 29 ans. Quant à l’obligation de renouveler sa déclaration, elle a été peu appliquée : seul un quart des primo-déclarants l’ont respecté au moins une fois sur trente ans, alors que la loi prévoit un renouvellement tous les cinq ans. Pis, seulement 1% des déclarations déposées l’ont été à la fin des fonctions. Encore une preuve de l’inutilité d’un dispositif légal basé sur le secret et l’absence de contrôle.
Pour formuler nos recommandations, nous nous sommes appuyés tant sur les failles observées, que sur une étude des expériences comparées. Nous avons aussi accordé un intérêt particulier à l’analyse projet de loi gouvernemental 89/2017 déposé au parlement et des propositions de lois émanant des élus.
C’est pourquoi Barr al Aman appelle à intégrer ces trois principes dans la prochaine législation qui encadrera la déclaration de patrimoine :
Publier
Les déclarations doivent être publiques afin que la société civile, les journalistes et a fortiori les citoyens puissent regagner confiance dans les institutions de l’Etat et exercer un droit de regard sur leurs représentants. Ceci permettra aussi d’élargir le contrôle à moindre coût.
Numériser
Les déclarations doivent être numériques afin de limiter le coût de gestion et faciliter le traitement et surtout prendre le moins de temps possible aux déclarants.
Contrôler
Le contrôle doit être systématique sur les fonctions les plus importantes et porter de manière aléatoire sur une partie des autres fonctions.