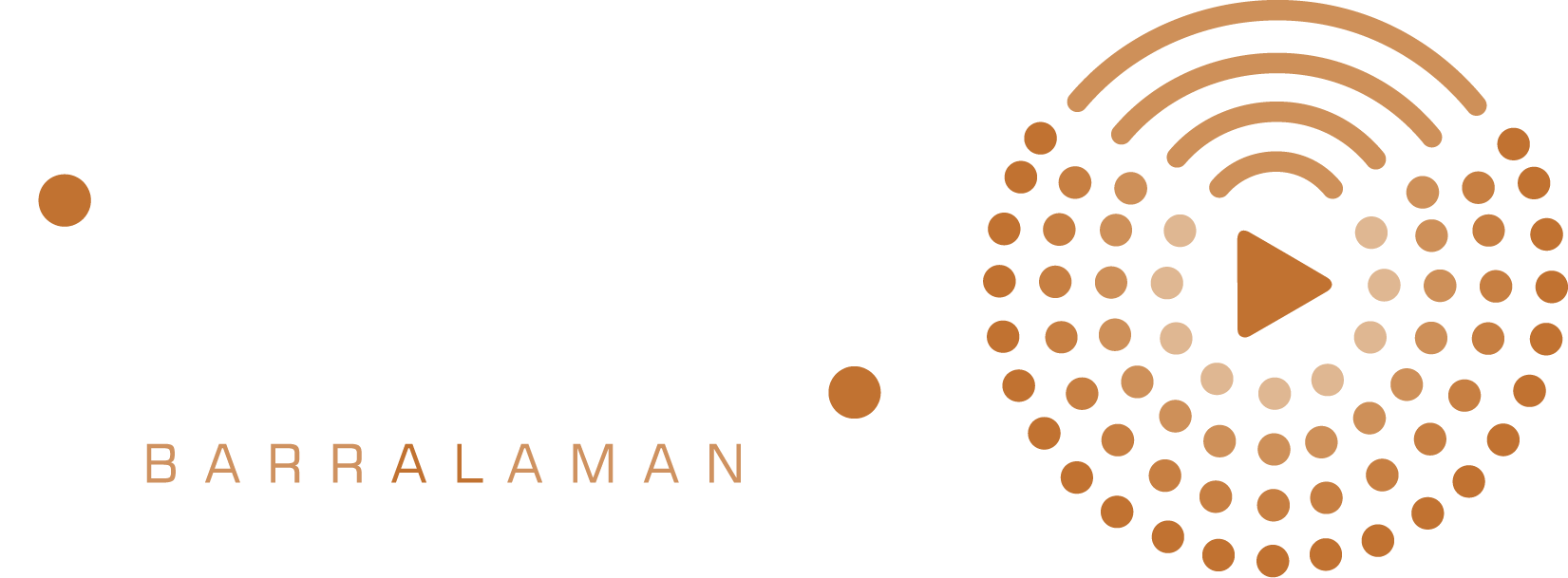Contents
MH: Quelle est votre définition de la sécurité nationale?
C’est la capacité d’un Etat à protéger ses citoyens, son territoire, sa souveraineté dans la prise de décision en utilisant tous les moyens en sa possession.
Avant on pensait toujours que les voisins étaient “les ennemis potentiels” ; mais cette notion a perdu de son sens aujourd’hui car le danger terroriste est partout. Ton voisin est celui qui peut notamment te protéger de ce fléau, à l’image du voisin algérien qui garde notre frontière commune sur le front ouest. Toutefois, côté libyen, on souffre considérablement de l’absence d’un vis-à-vis stable, car il n’y a pas d’Etat.
La sécurité intérieure et extérieure sont entremêlées. On ne peut pas assurer la protection des menaces extérieures, s’il y a une anarchie à l’intérieur des frontières. Il ne faut donc pas privilégier la gestion d’une menace intérieure aux dépens de l’extérieure et vis-versa.
MH: Quel a été votre parcours ? Comment êtes-vous arrivé à Carthage en 2015?
J’ai passé 20 ans en tant que Commandant à bord d’un navire militaire. J’ai réussi le concours pour suivre un Master en sécurité nationale axé sur le contre terrorisme aux Etats-Unis. A l’issue de cette formation, j’ai été appelé à reprendre du service au cabinet du ministre de la Défense, fin 2010 en plein printemps arabe.
Je préparais les dossiers, c’est à dire que je lui fournissais avant les réunions des synopsis de la situation. Le ministre recevait également une mise au point des renseignements. Appréciant le travail que je faisais, il m’a nommé à la tête de cette direction du renseignement militaire avec l’accord de feu Béji Caïd Essebsi qui était alors premier ministre.
Après 2012 et l’arrivée de M. Moncef Marzouki à Carthage, nous avons eu des différends dont je ne souhaite pas parler et qui touchent aux intérêts de la Tunisie et de l’armée. Résultat: je n’ai pas été maintenu à mon poste. Il m’a proposé d’être attaché militaire à notre ambassade à Tripoli (Libye) j’ai refusé. J’ai été envoyé aux Emirats Arabes Unis, j’y ai passé un an et deux mois. Peu avant son départ fin 2014, il m’a mis à la retraite.
En 2015, alors que j’étais encore aux Emirats, j’ai été contacté par Mohsen Marzouk (directeur de cabinet au palais présidentiel) et il m’a dit que le président Essebsi récemment élu aimerait me confier une mission en relation avec la sécurité. J’ai proposé de prendre en charge l’architecture du conseil national de sécurité.
MH: La Constitution a précisé en grande partie la composition de ce conseil. Quelle a été votre marge de manœuvre?
Selon la constitution, le conseil national de sécurité (CNS) est présidé par le président de la République qui convoque le conseil, ce dernier ne peut se réunir qu’en présence du chef du gouvernement et du président du parlement.
Le conseil national de sécurité tunisien a cette particularité: la présence du président de l’assemblée des représentants du peuple. Pourtant, les conseils de ce type ont en général une vocation opérationnelle et leur composition est souvent limitée à des représentants de l’Exécutif. Nous avons également prévu d’inclure le chef de l’agence nationale du renseignement ainsi que le conseiller chargé du CNS.
MH: Quelle était l’architecture du conseil précédent?
Avant la publication du décret du CNS en 2017, nous avons travaillé sur la base du conseil mis en place par Ben Ali en 1990 qui s’appelait alors “le Conseil national pour la sécurité”. Il y avait le chef de l’Etat mais aussi les ministres de la défense, de l’intérieur, des affaires étrangères, le chef des armées, le secrétaire d’Etat en charge de la sécurité et le directeur de la sécurité militaire.
Pourquoi cette composition posait problème? D’abord, le chef des trois armées en Tunisie n’exerçait qu’un rôle logistique et non opérationnel, cela émane d’une décision politique datant de 1979 à l’occasion de la réorganisation de l’armée en Tunisie. L’objectif était d’éviter de concentrer tous les pouvoirs aux mains d’un seul homme. Concernant la présence du chef de la sécurité militaire, c’était pour flatter l’ego de Ben Ali qui a occupé ce poste. En effet, il ne fallait pas qu’il ait l’impression d’être dans un poste bidon.
Je me souviens avoir parlé avec le Général Kateb, chef des trois armées en 1987, il m’a expliqué que le conseil se réunissait chaque semaine. Ben Ali a considéré que les militaires étaient trop impliqués, alors il a décidé de les écarter progressivement.
MH: Quelles étaient vos réserves par rapport à cette institution dans sa version de 1990?
Selon moi, le CNS a une vocation “politico-stratégique”. Cependant, la composition de 1990 est plus d’ordre “opérationnel stratégique” considérant la présence des techniciens. Ainsi, certaines personnes présentes aux réunions du “ Conseil national pour la sécurité” de 1990 se retrouvaient en présence de leurs supérieurs, ils ne prenaient pas la parole.
Par conséquent, je pense que l’opérationnel a besoin d’une vision émanant du politique. Le point de liaison entre l’un et l’autre ce sont les ministres, le chargé du CNS et le directeur de l’agence de renseignement. Après la mise en place du CNS conformément à la nouvelle constitution, il y a désormais plus de liberté de parole grâce à une harmonie hiérarchique des parties prenants.
Notre manière de travailler est celle des groupes de travail. Les commissions fonctionnent comme des think-tanks. C’est un think tank stratégique et non un gouvernement parallèle. Contrairement aux critiques émises au moment de la publication du décret en 2017. Je formule une proposition au président de la République qui la soumet au conseil. S’il y a une égalité de voix, c’est le groupe où se trouve le président qui a le dernier mot.
MH: Pourquoi l’agence nationale du renseignement n’a-t-elle pas encore vu le jour?
J’y travaille depuis 2011. Il y avait beaucoup de résistances au sein des ministères de l’intérieur et de la défense pour ce projet d’agence commune. Chaque partie aimerait avoir le lead. Le politique aimerait disposer de cette machine, le chef de l’Etat aimerait en disposer le chef du gouvernement aussi.
Nous avons constaté que nos services au sein des ministères de l’intérieur et de la défense ne se coordonnaient pas. Il faut un espace d’échange. C’est le rôle de cette agence. Un agent est désormais obligé de partager une information qu’il détient avec les autres services, sinon il est puni. Des bases de données communes sont aussi prévues.
Le président de l’agence nationale du renseignement préside un conseil avec les différents chefs des services. Il n’a cependant aucun pouvoir de décision, tout est transmis au conseil national de sécurité. Il propose mais ne décide pas.
Il me semble pertinent que le président de cette agence soit nommé au rang de ministre, à l’image de la Serbie. Le président de l’agence y est nommé par le président, il obtient la confiance du parlement, il exerce sous la tutelle du chef du gouvernement. Il peut donc s’adresser aux ministres de la défense ou de l’intérieur et avoir la légitimité de demander les informations à ces ministres. Le chef de l’Etat Essebsi n’a pas voulu, il a temporisé en proposant de rouvrir ce dossier par la suite.
MH: Deux cadres du renseignements au sein du ministère de l’Intérieur ont été arrêtés durant cette législature pour avoir rencontrer des personnes peu fréquentables, c’est pourtant le propre des agents de renseignement?
Effectivement, il n’y a pas de loi qui encadre le renseignement. La loi organique du renseignement est un chaînon essentiel de la sécurité nationale, elle a été préparée par la présidence de la République à Carthage avec la contribution des ministères de la défense, de l’intérieur, des affaires étrangères. Mais elle piétine à la Kasbah (siège de la primature). Il y a des aller-retours mais ça traîne et ce ne sont pas les tensions politiques entre les deux têtes de l’exécutif qui en sont la cause.
Concernant l’état d’urgence, nous avons malheureusement un décret inconstitutionnel qui régit cet état d’exception qui n’a pas été adopté par l’Assemblée à temps.
MH: Le Ministre de l’Intérieur a récemment déclaré que des dispositifs d’auto-détection ont été mis en place via caméra de surveillance. Que peuvent-elles reconnaître au juste? Les plaques d’immatriculation ou bien les visages?
Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais, je sais qu’en Chine par exemple il y a un système performant de caméras qui permet d’avoir l’identité d’un citoyen dès qu’il est aperçu par une caméra. La caméra est là pour protéger les citoyens et non le voleur, je ne vois pas où est le problème.
MH: Nous avons le même système qu’en Chine?
Je ne peux pas vous répondre.
MH: Le fait qu’il y ait des acteurs nouveaux comme la justice soumis aux nouveaux rapports de force politique. Qu’est-ce que ça change pour vous?
Notre justice est indépendante, c’est le principe de base, cependant, il arrive qu’il y ait des juges qui ne sont pas indépendants. Cependant, que ce soit pour les médias ou pour la justice, tout va se réguler avec le temps. Même en tant que spécialiste du renseignement, je préfère qu’il y ait une liberté d’expression et une parole libre qu’au silence qu’on connaît en dictature.
—-