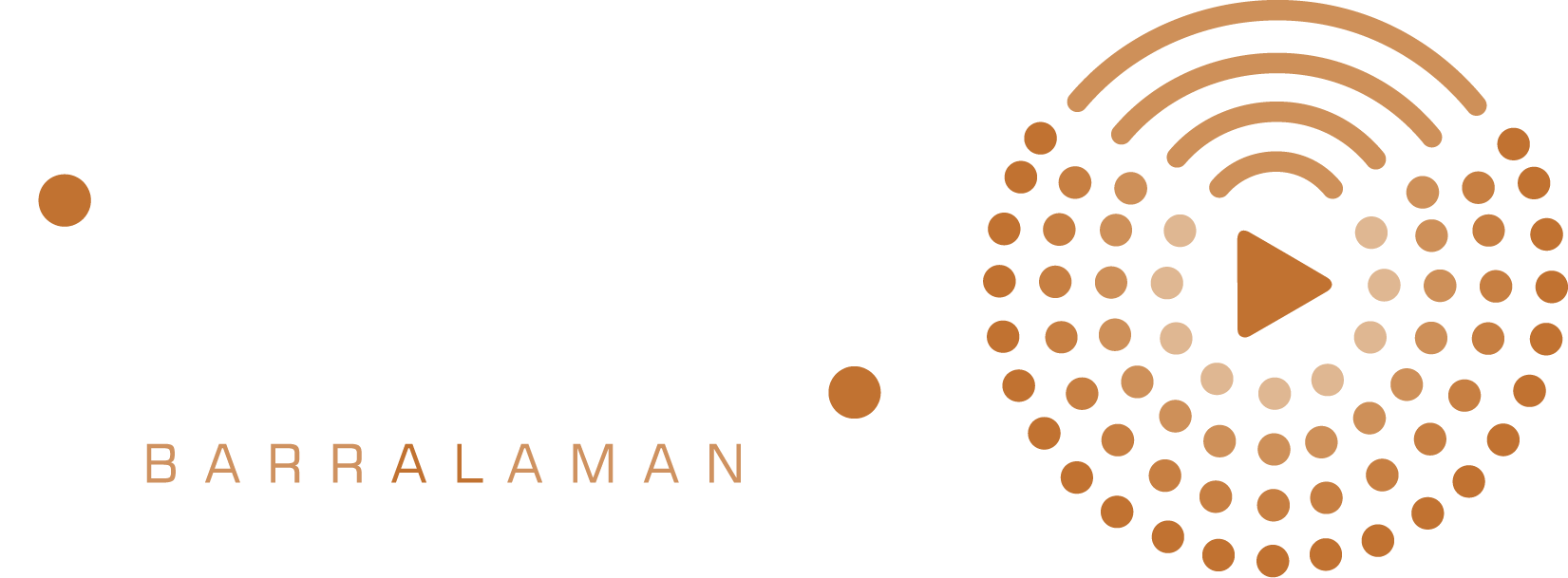Contents
Par Mohamed HADDAD à Jemna, Kebili.
Pour les habitants de Jemna, faire la révolution équivaut à une réappropriation des terres. Le 12 janvier 2011, deux jours avant la fuite de Ben Ali, les habitants voient déjà la fin du régime. Et en attendant sa chute, ils s’emparent d’une palmeraie « propriété privée » de l’Etat, exploitée par des investisseurs privés proches du clan de l’ancien dictateur. Dans ce village à 600 km au sud de Tunis, l’association de protection des oasis de Jemna est créée et prend en charge l’exploitation. En cinq ans, le chiffre d’affaires explose… il est porté à 1,7 millions de dinars (plus de 700.000€) pour la récolte 2016/2017.
L’impact au niveau local est indéniable: le nombre d’employés passe de 6 agents de gardiennage à 150 salariés et saisonniers. L’ONG ne s’arrête pas là: 2000 palmiers plantés, une ambulance, des salles de cours, une salle de sport, des équipements informatiques pour la garde nationale (gendarmerie), subventions d’associations culturelles… Un bilan riche pour cinq années d’activité. Pourtant, le compte bancaire de cette ONG est aujourd’hui gelé par l’Etat qui réclame son bien, un bras de fer qui dure depuis plusieurs mois. « Le droit est contre nous, mais le bon sens nous donne raison » Ibrahim Khamar l’assène en arabe littéraire rutilant comme une formalité, une évidence. Mais difficile de peser dans la balance de la justice, quand la partie adverse est justement… l’Etat. Le 15 septembre dernier, le tribunal de première instance de Kebili a annulé l’organisation de la vente aux enchères de la récolte suite à une plainte du chargé du contentieux de l’Etat. Une vente qui a été repoussée à plusieurs reprises et qui a quand même eu lieu en grande pompes, le 9 octobre en présence même de certains députés de l’opposition et de la majorité.
« Nous avons toujours été mis de côté… Hors de question de quémander à l’Etat quoique ce soit. » Tahar Ettahri, président de l’association et prof de français à la retraite, barbe et cheveux blancs, clairement nourri à la pensée de la gauche des années 70. « Encore faut-il qu’on nous laisse travailler! » Pour ce représentant local d’Amnesty, la terre appartient aux ancêtres des habitants de Jemna. Taher reste cependant réaliste « Dans la situation actuelle, c’est l’Etat qui en est propriétaire, et bien qu’il nous la loue alors! » La demande de régularisation de la situation de l’association a été clairement formulée aux ministères concernés. Début octobre, une sortie de crise est évoquée: verser la somme – 1,7 millions de dinars – de la vente à la caisse des dépôts, après règlement des charges des années passée et en cours. La fin de la de crise semblait proche et l’optimisme de mise. Du jour au lendemain, l’Etat quitte symboliquement la table des négociations sans préavis, gelant les comptes de l’acheteur de la récolte 2016 et celui de l’association.
Frustration et sentiment d’injustice
“On devrait recevoir des distinctions et des honneurs pour cet exploit” s’indigne Tahar Ettahri. La Tunisie doit mettre en place la décentralisation comme le stipule la constitution de 2014, “et nous avons ici un laboratoire d’économie sociale et solidaire, de gestion décentralisée… une expérience pionnière! Ceux qui vont écrire les lois devraient venir ici pour s’en inspirer” ajoute-t-il. Résultat: grande frustration à Jemna.
Hérité de cinquante ans de dictature, le sentiment d’injustice de la périphérie vis-à-vis du centre demeure six ans après le départ de Ben Ali une plaie ouverte. « L’Etat a peur de voir l’expérience de Jemna réussir. Si ça marche ici, ça s’étendra sur tout le pays. » Ettahri met au défi l’Etat tunisien mais il sait pertinemment que la bataille qui les oppose n’est pas une affaire de loyers impayés, ni de rentabilité. Selon lui, Jemna doit servir d’exemple pour calmer les velléités d’autonomie et de réappropriation foncière dans les autres régions. Le ministère de l’agriculture – par le biais de l’office des terres domaniales – gère plus de 820 000 ha de terres en friche, d’oliviers, d’agrumes ou d’arbres fruitiers, etc. Des voix s’élèvent contre l’idée de la propriété privée de l’Etat, arguant: « si quelque chose appartient à l’Etat, elle appartient donc au peuple ».
Cléments pour les puissants
A Jemna, la posture de l’Etat est ressentie comme une injustice, et une parfaite illustration du deux poids, deux mesures. En effet, le parlement a validé une loi régularisant l’exploitation illégale des carrières de marbre de Thala (Kasserine, centre-ouest) pendant les cinq années suivant la révolution. Cette loi n’est pas entrée en vigueur et a été portée par des députés de l’opposition à la cour constitutionnelle provisoire. Ce projet de loi a été déposé à l’assemblée des représentants du peuple par le ministère des domaines de l’Etat en 2015, celui-là même qui poursuit en justice l’association de Jemna.
Encadré: « Ferme du colonisateur »
Par exemple, à Jemna, cette terre est appelée par ses anciens propriétaires ou exploitants: « Ferme du colonisateur » ou « Ferme de la STIL », comme si elle n’a jamais été la leur. Elle incarne les zones d’ombre de l’histoire de la Tunisie. Sous Ben Ali, elle était louée à deux hommes d’affaires proches du régime contre un loyer annuel moyen de 80.000 dinars (35000 euros) mais leur chiffre d’affaires n’a pas été rendu public. Auparavant, l’Etat le louait à la STIL – société tunisienne d’industrie laitière – une compagnie qui regroupait certains caciques du régime bourguibiste. L’entreprise a fini par faire faillite. Pour pouvoir louer ces terres, l’Etat tunisien avait renoncé au modèle économique des coopératives consistant en la collectivisation des terres, une étape socialiste qui a duré dix ans et avait commencé au lendemain de la décision d’évacuation agraire en 1964. Le jeune Etat post-indépendance décide de « tunisianiser » ses terres et les rachètent aux colons. Avant la colonisation, les habitants de la région utilisaient ces terres pour avoir une production vivrière. En remontant encore le fil de l’histoire, à la fin du XIXe, la Tunisie était un royaume qui avait gagné en autonomie par rapport à l’empire ottoman. Les terres appartenaient au Bey quant aux Tunisiens, étaient ses sujets et non des citoyens. Ces terres ont été « données » donc aux Français voulant se donner la peine de venir en Tunisie. Il faut remonter aussi loin pour trouver le point où les habitants de la ville pouvaient travailler leurs terres et en tirer directement bénéfice.